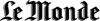 - 20 mai 2006
- 20 mai 2006On peut arguer que l'Iran ne ressent pas le même besoin maintenant. A l'heure actuelle, deux interprétations sont possibles. L'une est que les Iraniens cherchent à nous isoler, et qu'ils sont très confiants dans l'avenir. Ils penseraient pouvoir tenir ainsi jusqu'à la fin du mandat du président Bush dans deux ans. L'autre interprétation, c'est que si les Etats-Unis arrivent à faire émerger un consensus, aidés par la politique des Européens, alors les Iraniens, isolés, voudront peut-être explorer la voie d'une solution.
Personnellement, je penche plutôt pour la seconde interprétation. Si nous pouvons obtenir une résolution raisonnable à l'ONU, alors nous, les Etats-Unis, devrions être prêts à participer à des négociations sur sa mise en oeuvre.
Un accord avec l'Iran faciliterait-il un retrait américain en Irak, comme cela a pu être le cas au Vietnam au moment du rapprochement avec la Chine ?
Nous avions pris la décision du retrait du Vietnam dans les premiers mois de l'administration Nixon. Et lorsque je suis allé en Chine, nous avions déjà retiré entre 200 000 et 250 000 soldats du Vietnam. Le voyage en Chine a accru le sentiment d'isolement du Vietnam. Les Vietnamiens ont fait encore une tentative, avec la grande offensive de l'été 1972, mais lorsqu'elle a échoué, ils ont évolué très rapidement vers un règlement.Cela pourrait se produire ici aussi, mais l'affaire ne sera pas terminée pour autant. La solution ne peut être qu'un arrêt de l'enrichissement d'uranium. Je ne crois pas que les Etats-Unis accepteront autre chose que cela. Mon impression est que la France et les Etats-Unis partagent substantiellement le même point de vue sur ces questions.
Les Européens doivent-ils pousser les Etats-Unis à contribuer à des mesures incitatives pour l'Iran, à utiliser, autrement dit, un peu plus la carotte et un peu moins de bâton ?
Je pense que l'administration américaine est bien consciente de la position européenne sur ces questions. Etant donné l'histoire de nos relations avec l'Iran, incontestablement, l'idée de formuler des mesures incitatives pour l'Iran va à l'encontre de l'approche américaine de ce pays. D'un autre côté, si on réfléchit à ce problème de façon systématique, tout règlement doit comporter des incitations pour l'Iran. Je crois que nous serons capables de parvenir à un accord là-dessus.
Certains aux Etats-Unis veulent un changement de régime, ne croient pas à une négociation avec l'Iran et s'opposent à toute concession significative. Mon instinct est, d'un point de vue intellectuel, que, clairement, toute négociation avec l'Iran doit comporter des incitations et des pénalités. Il faut qu'il y ait les deux.
D'autres pensent que nous devrions leur offrir de la technologie nucléaire avancée. Je ne suis pas très rassuré sur ce point. Je ne le ferais pas. Il faut sans doute des mesures incitatives dans le domaine technologique, mais cela me pose problème.
L'une des réserves formulées sur la menace du recours à la force militaire contre l'Iran est que l'opinion publique américaine, très marquée par la guerre en Irak, y serait sans doute opposée. Comment l'Amérique peut-elle se sortir de l'affaire irakienne ?
Nous ne pouvons pas en sortir dans des délais assez rapides pour que cela affecte la négociation sur l'Iran. Sur l'Irak, il y a deux questions : comment pouvons-nous en sortir ? Et comment déboucher sur une issue qui n'ait pas de conséquences très fâcheuses pour tout le monde, y compris pour ceux qui étaient opposés à notre intervention en Irak ?
Si un régime de type fondamentaliste ou taliban émerge dans une partie, quelle qu'elle soit, de l'Irak après un retrait américain, ou pendant un retrait, et si le pays sert de base à des activités fondamentalistes, radicales, cela affectera tous les pays abritant des populations musulmanes, de l'Europe à l'Asie du Sud-Est, y compris l'Inde.
Nous avons donc tous un intérêt à ce que l'issue soit laïque et non djihadiste. Et c'est très difficile, pour tout le monde. D'un point de vue intellectuel, on pourrait dire que jusqu'à récemment, les sunnites ont pris les armes parce qu'ils pensaient avoir les Américains à l'usure et, au bout du compte, vaincre les chiites. Aujourd'hui, les chiites sont si forts que les sunnites ne pensent probablement plus pouvoir les vaincre et envisagent même leur propre défaite. De telle sorte que les sunnites, ironiquement, pourraient rechercher une protection contre les chiites. Les chiites, après des siècles de domination, pourraient ne pas être confiants dans le fait qu'ils puissent gagner. Et les Kurdes veulent tout ce qui leur donnera un maximum d'autonomie.
Imaginons les conséquences d'un retrait américain rapide : la Turquie serait fortement incitée à agir dans les régions kurdes. De même, les Iraniens voudraient dominer dans le sud. Les Etats musulmans sunnites pourraient être tentés de dresser une sorte de barrière contre les chiites. Et parallèlement à tout cela, il y a le risque de guerre civile : un cauchemar pour tout le monde, qui poserait la question d'une nouvelle intervention étrangère. Je pense donc qu'un retrait américain rapide n'est pas souhaitable. Et je n'aime pas le débat politique actuel aux Etats-Unis. J'ai déjà vu ça avec le Vietnam. Une fois qu'on commence à entrer en compétition politique sur ce thème, on donne un avantage énorme à l'ennemi sur le terrain.
Partagez-vous l'opinion du vice-président Dick Cheney lorsqu'il accuse le président Poutine de faire du chantage à l'énergie sur les pays européens ?
Vladimir Poutine dirige un pays qui a perdu trois cents ans d'hégémonie. C'est un pays qui, historiquement, par ses actions à l'étranger, s'identifie avec ce que l'on appelle maintenant l'impérialisme. La Russie n'a jamais tiré fierté de ses réalisations intérieures. Aujourd'hui, les Russes sont revenus à leurs frontières initiales, et ils ont un problème d'identité : qui sont-ils ?
Ce que veut Vladimir Poutine, je crois, c'est faire de la Russie un acteur majeur dans les relations internationales, lui rendre sa dignité et son rang, et utiliser cela pour encourager ses compatriotes à fournir les efforts nécessaires à l'intérieur.
Il est donc difficile de distinguer ce qui est du chantage de ce qui est l'affirmation d'une identité. Dans un sens, c'est du chantage, mais je crois que ce que veut surtout le président russe, c'est être reconnu, en surtout par les Etats-Unis, comme un partenaire égal. Et je crois que pour atteindre cet objectif, il serait prêt à des ajustements. Donc paradoxalement, plus nous avons une attitude de confrontation, plus cela fait ressortir le côté brutal de l'histoire russe.
Mais la politique extérieure de la Russie n'est pas la seule en cause, il y a aussi la façon dont M. Poutine gère les affaires intérieures...
Certes, ce n'est pas démocratique. Les traits autocratiques du régime se sont incontestablement renforcés. Mais si vous regardez bien, depuis l'effondrement du communisme, il n'y a pas eu de grande période, sur le plan intérieur, en Russie. Sous le régime de Boris Eltsine, il y a eu la corruption et les chars dirigés contre le Parlement, avec Vladimir Poutine il y a renforcement du pouvoir central.
Bien sûr, plus de démocratie serait souhaitable. Mais de manière générale, je crois qu'une approche plus compréhensive de notre part est préférable à celle de la confrontation ouverte. Les Russes doivent savoir que l'on réagira à l'oppression. Mais essayons d'éviter le test de virilité...
Vous avez formé, avec le président Richard Nixon, un vrai tandem. Voyez-vous dans le tandem George Bush-Condoleezza Rice une coopération aussi étroite ? Condoleezza Rice peut-elle être le Kissinger du XXIe siècle ?
Le président Nixon avait sa propre personnalité et son propre background. Je ne connaissais pas George W. Bush avant son élection à la Maison Blanche. J'ai appris à le connaître et à l'apprécier : il est très bon sur les grosses décisions. En dehors de l'affaire de l'intervention en Irak, sur laquelle nous avons eu des divergences importantes, je crois que cette administration a pris de bonnes orientations. D'abord en favorisant le dialogue avec l'Europe. Et sur pratiquement tous les grands sujets, en prenant des orientations compatibles avec ce que je perçois être les aspirations européennes.
Condi a passé une bonne partie de sa vie à étudier la politique étrangère, ce qui n'était pas le cas du président, et ils ont une grande confiance l'un dans l'autre : il n'y a donc pas de tensions bureaucratiques entre eux. J'ai beaucoup d'estime pour Condi. Lorsque le chancelier allemand Adenauer a eu 85 ans, quelqu'un lui a souhaité de vivre jusqu'à 120 ans et il a répondu : pourquoi mettre une limite à la grâce de Dieu ? Je dirais la même chose pour Condi : pourquoi seulement la comparer à moi ?


